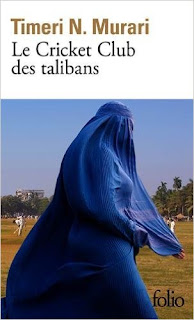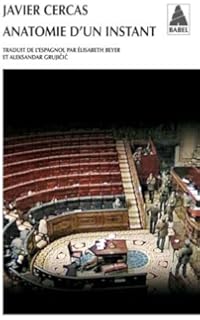|
Le style de Ian McEwan, remarquable en anglais dans Enduring Love, est aussi plaisant traduit en français. Un mélange d'élégance et d'ambiguïté voire de roublardise, car McEwan est un adepte du mélange des genres et du jeu entre fiction et réalité. Particulièrement ici, dans ce qui semble être le récit autobiographique d'une espionne : Serena Frome (prononcez Frume, comme c'est précisé), fille bien née d'évêque anglican, est embauchée au MI5 à l'issue de sa licence de maths à Cambridge, à la fin des années 1960. Dans une ambiance qui mêle guerre froide et machisme à l'ancienne, elle prend part à une opération de recrutement d'écrivains favorables au camp occidental, fait connaissance dans ce cadre avec un jeune auteur de nouvelles, T.H Haley dit Tom. Et tombe amoureuse, bien sûr. La suite, lisez-la vous-même, ce serait dommage de dévoiler ici la surprise (la supercherie ?) du livre.
J'ai apprécié le personnage de Serena, la fille à la fois inculte, bien élevée, belle et déterminée. Une grande lectrice, Serena. Pas au sens littéraire, au sens quantitatif. Je suppose que bien d'autres lectrices amateures s'y retrouvent.
Extraits
"Je pouvais engloutir un bloc de texte ou tout un paragraphe en une seule gorgée visuelle. Il me suffisait de laisser mes yeux et mes pensées se ramollir comme de la cire pour que les mots s'y impriment aussitôt. Au grand agacement de mon entourage, je tournais les pages toutes les quelques secondes d'un coup de poignet impatient. Mes exigences étaient simples. J'attachais peu d'importance aux thèmes ou aux phrases bien tournées, je sautais les descriptions soignées du temps qu'il faisait, des paysages et des intérieurs. Il me fallait des personnages auxquels je puisse croire, et je voulais que l'on me donne envie de savoir ce qui allait leur arriver. En général, je préférais qu'ils tombent amoureux ou se séparent, mais je ne leur en voulais pas trop s'ils essayaient de faire autre chose. C'était une attente vulgaire, mais j'aimais entendre avant le dénouement quelqu'un demander : "Veux-tu m'épouser ?" Les romans sans héroïnes ressemblaient à un désert aride. Conrad était trop loin de mes préoccupations, comme la plupart des nouvelles de Kipling et de Hemingway. Je ne me laissais pas davantage impressionner par la réputation d'un auteur. Je lisais ce qui me tombait sous la main. Romans de gare, grande littérature, et tout ce qu'il y avait entre les deux : je réservais à chaque livre le même traitement cavalier."
Ian Mc Ewan, Opération Sweet Tooth, p. 20-21
"J'avais soif d'un certain réalisme naïf. Je prêtais une attention particulière, tendais mon cou de lectrice à la moindre mention d'une rue londonienne que je connaissais, de la coupe d'une robe, d'une célébrité de la vie réelle, d'une marque de voiture, même. Là, au moins, je disposais d'une unité de mesure, je pouvais juger la qualité de l'écriture à l'aune de son exactitude, de sa capacité à recouper mes propres impressions ou à les embellir. (...) Je n'étais pas convaincue par ces écrivains (éparpillés à travers les continents sud et nord-américains) qui envahissaient leur propres pages comme s'ils faisaient partie de la distribution, bien décidés à rappeler au malheureux lecteur que tous les personnages, eux-mêmes compris, étaient pure invention et qu'il n'existait aucune différence entre la vie et la fiction. Ou à insister, au contraire, sur le fait que la vie était de toute façon une fiction. Selon moi, seuls les romanciers risquaient de confondre les deux. J'étais une empiriste-née."
Ian Mc Ewan, Opération Sweet Tooth, p. 105
"La misanthropie ou la haine de soi - étaient-elles si éloignées ? - devaient faire partie de sa nature. Je découvrais que l'expérience de la lecture est faussée lorsque l'on connaît l'auteur, ou qu'on s'apprête à le rencontrer. J'avais pénétré dans l'esprit d'un inconnu. Mue par une curiosité grossière, je me demandais si chaque phrase confirmait, niait ou masquait une intention secrète. Je me sentais plus proche de Tom Haley que si je l'avais eu comme collègue au Fichier central ces neuf derniers mois. Mais malgré ce sentiment de proximité, difficile de dire ce que je savais au juste. Il me fallait un outil, un instrument de mesure, l'équivalent narratif d'un compas de navigation pour calculer la distance séparant Haley d'Edmund Alfredus."